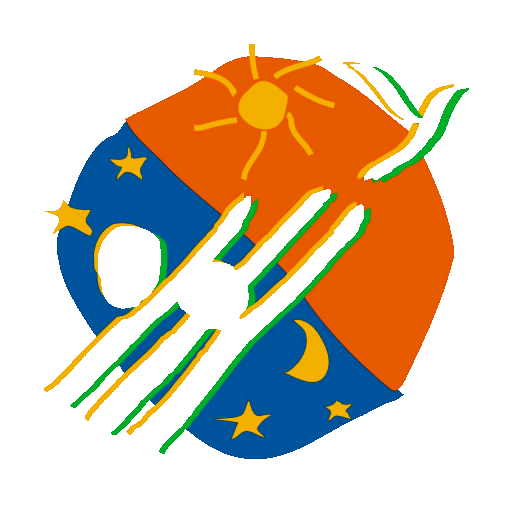Caroline et Annie sont deux jeunes femmes, deux mamans, l’une de trois, l’autre de quatre enfants. Elles rentraient après être allées chercher « le pain couché » comme on dit en Côte d’Ivoire. On appelle ainsi le pain de la journée, qui n’a pas été vendu par les boulangeries et qu’on leur donne le lendemain. Elles le revendent à bas prix dans le quartier précaire où elles vivent. Un quartier où s’alignent, sans la distance qui permettrait un peu d’intimité, les baraques de planches, les unes à côté des autres.
Le jour de notre rencontre, elles n’avaient pas eu de pain. Elles rentraient chez elles, chacune avec un bébé au dos, retrouver leurs autres enfants. Juste devant chez moi, elles ont osé m’aborder « Tu n’aurais pas du travail ? »
Quand Caroline m’a dit son prénom, le même que moi, j’ai entendu un appel. « Je n’ai pas de travail, mais je peux t’offrir mon amitié. Je viens d’arriver ici, je ne connais rien. Toi, c’est chez toi, tu peux m’apprendre des tas de choses. » Nous nous sommes données des rendez-vous et elle m’a fait découvrir le quartier : les usines d’attiéké, cette semoule de manioc, base de l’alimentation ivoirienne, le marché, la décharge, l’endroit où l’on fume le poisson… Elle a ouvert mes yeux sur tant de choses que, comme étrangère, je ne pouvais pas voir.
Et puis, un jour « tiens, là c’est chez moi, on entre. » Notre amitié s’est tissée ainsi, lentement, jour après jour.
Pas à pas, je leur parle de mon engagement, et je leur ai dit mon rêve de monter un groupe d’enfants Tapori, des enfants solidaires qui se donnent des forces pour apprendre ensemble, des enfants qui à travers des activités artistiques et culturelles tissent des amitiés et contribuent à leur façon à changer le monde, à changer le regard porté sur la misère… Au début, elles m’ont à la fois dit leur enthousiasme et aussi leur stress de se lancer dans ce projet alors qu’elles cherchent du travail. Et puis petit à petit, elles sont revenues vers moi. Elles ont trouvé un terrain où il y a de la place et de l’ombre, au cœur du quartier où elles vendent le pain et donc où elles connaissent tant de familles.
Est-ce que ce n’était pas injuste, alors qu’elles n’ont rien, de leur demander un travail gratuit ? Si je demande leur aide, c’est parce qu’ensemble on peut faire quelque chose. Je ne peux rien sans elles.
C’est là qu’Annie m’a dit « Certes, on n’a rien, on est dans le besoin, mais on peut transmettre quelque chose. » C’est tout cela qui m’émerveille. Quand Caroline me raconte comment elle fait attention à des femmes qui peinent plus qu’elle et comment elle leur garde un pain gratuit. Je suis témoin de leur quotidien difficile, de leurs épreuves, de leurs luttes. Et aussi de leur espérance d’un avenir meilleur, de la foi extraordinaire qui les porte.
Caroline Blanchard, Côte d’Ivoire