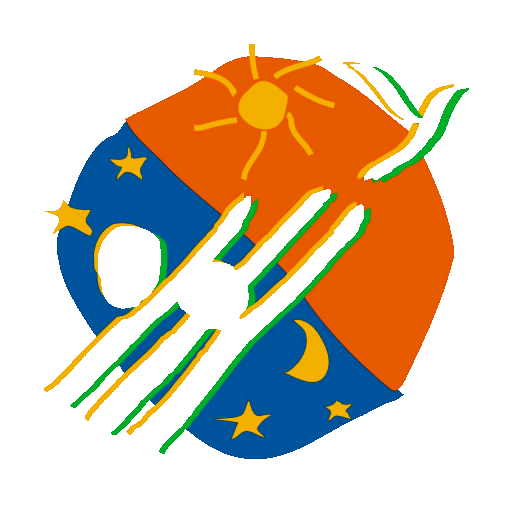Réflexions de Sandra Sanchez après la lecture du rapport sur les dimensions cachées de la pauvreté.
La méthodologie.
La méthodologie de cette étude m’a fait penser au sociologue colombien Fals Borda qui a conçu un système de recherche actif-participatif dans le but de, à la fois, créer un savoir collectif et collectiviser ce savoir. L’académie fournit un important travail de recherche et de production de savoir, mais parfois très éloigné de la réalité. Cela remet en question les politiques et le fait que les décisions, les études et l’exercice professionnel puissent refléter la réalité que vivent les personnes, que le sujet soit la pauvreté ou d’autres problématiques. Ce rapport permet non seulement d’exposer une méthodologie et quelques aspects techniques, mais aussi de réelles personnes. On leur donne la parole, on donne de la voix et de la visibilité aux personnes qui ne peuvent rester oubliées dans ces dimensions cachées. Elles racontent ce qu’elles ressentent, ce qu’elles vivent, et le fait que leur témoignage soit non seulement recueilli dans un document, en vidéo, mais aussi mis en parallèle des réflexions des académiciens, des professionnels et des politiques, est extrêmement précieux. Le rapport indique que l’objectif à long terme est que ces politiques publiques et les décisions institutionnelles aient réellement pour but d’éradiquer la pauvreté. Pour comprendre un problème et trouver une solution, il faut chercher à la racine, aller dans toutes ces dimensions qui ne sont pas si simples à comprendre et qui semblent avoir été dissimulées par intérêt.
L’expérience centrale, les dynamiques relationnelles et les privations.
La question de la privation de pouvoir est très évidente. Quand une personne se lève chaque jour en se demandant comment alimenter ses enfants, comment survivre ; c’est ce qui s’est passé avec la pandémie, ce qui se déroule actuellement en Colombie (exemple qui m’est le plus immédiat et le plus personnel) ; les personnes n’ont évidemment ni le temps ni le pouvoir de décider de leur propre vie et il n’est pas facile de s’impliquer dans les décisions collectives, de participer politiquement, de comprendre le fonctionnement des rouages de la société afin d’agir.
Cependant, les communautés ont créé des façons collectives de s’organiser pour répondre à cette situation de précarité et de violence sociale. Des associations, des fondations, telle la fondation Oasis que nous avons crée à Paraíso. Dans mon quartier par exemple, quand il n’y avait pas d’eau potable, les personnes connectaient des tuyaux à trois heures du matin (car c’était illégal, bien sûr) aux endroits où elle était disponible. Ce qui est intéressant, c’est qu’il ne s’agissait pas d’un individu prenant de l’eau pour lui seul mais de plusieurs personnes qui toquaient à toutes les maisons, nous savions que c’était pour l’eau et nous sortions les récipients ; c’était un effort collectif pour que nous puissions tous avoir de l’eau. Et cela s’est reproduit pour la lumière et les services. J’ai grandi dans cet effort, d’abord grâce à mon père et à ma mère qui essayaient de nous nourrir, car nous sommes quatre enfants, mais aussi grâce à cette collaboration de la communauté. Il est important de prendre conscience de cette lutte et de cette résistance, ainsi que de toutes les injustices sociales et judiciaires (je suis avocate, j’ai obtenu une bourse d’une université privée de Bogota). Avoir conscience qu’il y a des personnes très investies dans cette résistance, mais qu’il y en a d’autres qui, de par leur situation personnelle, ne peuvent trouver les outils pour faire face à ces situations.

Des phénomènes sociologiques se manifestent partout. Lorsqu’on voit en périphérie de Paris les scènes de violence, on se rend compte que le sentiment des jeunes de n’avoir ni espoir ni opportunités, et celui de ne pas savoir quel sera leur rôle dans la société, génèrent beaucoup de frustration et de rage, et on peut presque parler de revanche contre la société, contre sa structure même, parce qu’ils ne peuvent faire partie de quelque chose, ne peuvent trouver leur place. Cela engendre beaucoup de problèmes de criminalité ; le souci est comment la structure institutionnelle y répond. Lorsqu’on se trouve en situation de précarité, il est beaucoup plus difficile d’être représenté légalement, d’être accompagné et défendu par quelqu’un, de comprendre ce qu’il se passe. À l’inverse, si une personne très riche et en position de pouvoir commet un délit, l’institution n’est ni objective ni équilibrée. Les situations d’injustice et de resocialisation, comme le nomme le système judiciaire, ne fonctionnent pas car les racines du problème se trouvent dans la vulnérabilité et dans les conditions dans lesquelles les personnes tentent de trouver leur rôle. Il y a de véritables systèmes de criminalité qui, en outre, recrutent et recherchent sans cesse des personnes ayant ce profil.
La dynamique relationnelle et la maltraitance institutionnelle.
La Colombie est un pays très inégalitaire et aux dynamiques relativement difficiles. Il y a des pays dans lesquels le problème de la discrimination raciale est clair ; pour nous, il est question de discrimination économique : « tu vaux ce que tu possèdes ». Nous avons un système d’échelons sociaux, allant de 1 à 6, que tout le monde essaie de gravir. Dans mon quartier, les habitants plaisantaient en disant « nous sommes échelon 0 », car nous n’avons ni services ni transports. Cela dit, le quartier s’est beaucoup amélioré et nous avons désormais, entre autres, un téléphérique conduisant à Paraíso. Mais il est le fruit d’une lutte menée par l’ensemble de la communauté et par des organisations qui ont clamé « nous sommes là », nous sommes ceux qui font le travail domestique, qui travaillent dans la sécurité, qui assurent les ventes et nous méritons de faire partie de cette ville, vous ne pouvez continuer de nous en exclure. Ce système de strates crée des conflits entre ces mêmes personnes qui disent « je refuse d’être considéré dans cette strate car on me discriminera dans mon travail, dans mes études ». C’est un système très pervers qui a causé beaucoup de dégâts.
La reconnaissance des communautés désignées pauvres est également importante, au sujet de l’écologie par exemple. Je me souviens que nous n’utilisions jamais de sacs en plastique car ils étaient payants, ainsi nous apportions nos paniers et nos sacs en tissu. Être pauvre coûte très cher. Les gens achetaient leur nourriture en petites quantités, l’huile ou le riz par exemple, car ils n’avaient pas les moyens d’acheter en grandes quantités. Mais économiquement, si nous faisons les comptes, cela revient beaucoup plus cher que de pouvoir faire des réserves alimentaires. Avoir un vélo en Colombie est indispensable et c’est un moyen de transport nettement plus économique que la voiture. Trouver un vélo, le réparer et pouvoir se déplacer. Cela semble très invisible car aujourd’hui le vélo est à la mode, il y a toute une conscience écologique, et il apparaît que nous les pauvres connaissions déjà toutes ces pratiques, parfois ancestrales, attachées au respect de l’environnement. Tout cela est aussi très lié aux traditions qui luttent contre la consommation, le capitalisme.
La conclusion essentielle est que le rapport est inspirant car il donne la parole aux personnes qui vivent dans la pauvreté. Il reconnaît leur savoir et leur valeur, et le fait qu’elles ont dû affronter ces situations précaires. De plus, elles y font des propositions. Lorsque cette femme parle de paix, je prends conscience du fait que malgré toute la violence qu’elles ont vécue, malgré leur situation vulnérable, ce sont les femmes qui, le plus, gardent espoir en la paix.